|
Lundi 6 décembre
Le petit déjeuner de l'hôtel Chuong Dong au bord
du Mékong, dans un cadre agréable, bien que la
terrasse ressemble plus à une cantine qu'à autre
chose, nous surprend. Pas de buffet comme partout, où
on a pris l'habitude de se régaler de crêpes, pan-cakes,
viennoiseries, oeufs durs, fromage et où sont également
proposés de vrais repas à l'américaine
que nous ne prenons jamais. Ce matin, on nous présente
une carte avec, au choix, un saladier de soupe vietnamienne,
des vermicelles au porc, du pain, de la confiture, du fromage,
pas de jus d'orange mais du jus de citron, et puis café,
thé...
Nous commandons pain, confiture, fromage, café, jus de
citron chacun. Et voilà le plateau qui arrive avec deux
pains de la taille de bâtards, deux cuillers à
soupe de confiture, deux portions de "vache qui rit",
deux cafés et deux thés. Nous rendons le thé
en réclamant des jus de citron comme prévu. Ils
arrivent tout fumants... avec de l'eau du Mékong peut-être...
Bon, sans doute pas, mais avec la chaleur qui règne déjà
ici, on n'a pas besoin de citron chaud.
Quant à pouvoir obtenir un peu de lait dans mon café,
la belle affaire ! Personne ne comprend l'anglais, je le demande
dans diverses langues : "milk, lait, latte, leche";
rien n'y fait ! Jean Paul pousse alors un "meuh" retentissant
et mime la traite d'une vache. On m'apporte aussitôt un
petit verre de lait concentré sucré, qui une fois
versé dans le café, en fait un truc sirupeux que
j'abandonne finalement, car je ne sucre jamais le café.
A 8h30, nous montons sur un bateau pour une nouvelle croisière
de trois heures sur le Mékong. Devant nous, le troisième
pont suspendu, construit par les Vietnamiens, enjambe les fleuves.
Le soleil tape dur. Sur notre gauche apparaît un village
flottant. Sous les maisons, sont installés des viviers
pour la pisciculture. Ici, le Mékong mesure 3 km de large.
A sa surface flottent quelques jacinthes d'eau.
Premier arrêt : nous visitons une fabrique familiale de
caramels de noix de cocotiers d'eau. Sous nos yeux, la pulpe
écrasée est pressée, pour donner le lait
de coco qui sera cuit 45 mn dans un four artisanal, le combustible
étant les écorces de coco après que les
fibres en aient été récupérées
pour fabriquer des tapis. Quant aux feuilles, elles sont utilisées
pour couvrir les maisons.
Le caramel chaud est versé dans des moules, coupé
et enveloppé dans des feuilles de papier de riz comestibles,
puis emballés pour être vendus. C'est bon, nous
en achetons quelques paquets. De retour au bateau, on nous offre
une grosse noix de coco percée et munie d'une paille
pour en aspirer l'eau.
Nous naviguons entre des îles dont Dung nous dit qu'avec
les phénomènes climatiques, elles disparaîtront
dans quelques années, englouties par l'eau dont le niveau
monte.
Devant nous à 110 km c'est la mer de Chine, derrière
à 160 km, le Cambodge. Le bateau se glisse dans un arroyo
(étroit bras d'eau) bordé de cocotiers d'eau,
c'est très joli. Nous croisons quelques barques paisibles,
les oiseaux sifflent. Sur les bords, des escaliers en béton
permettent d'accéder aux habitations implantées
derrière les cocotiers.

Deuxième arrêt : nous abordons
sur une île, véritable verger naturel, avec ses
maisons du delta en bois, couvertes de palmes de cocotiers.
Arrivés au village, après une marche à
pied à travers la verdure et les arbres fruitiers, on
nous fait monter dans une charrette tirée par un petit
cheval, on nous coiffe d'un chapeau pointu et en route. La conductrice
téléphone tandis que le cheval trotte. Deux mondes
en un seul, encore une fois !
Nous descendons au jardin de Bentre, où on nous offre
un thé au miel arrosé de jus de kumqwat et de
grandes assiettes de fruits, papayes, jacquier, longanis, ananas,
noix de coco séchée... Le miel est fait ici, on
a vu les ruches. Sur les étals autour de nous, sont exposés
des bocaux remplis de serpents car dans cet endroit, on élève
les cobras et les crocodiles que l'on retrouve sous forme de
sacs, ceintures, portefeuilles. Après ce délicieux
déjeuner de fruits, nous embarquons dans un sampan, qui
n'a pas l'air très stable. il faut rester bien au milieu,
ça roule d'un bord sur l'autre et c'est ainsi que nous
regagnons notre bateau initial. La femme debout à l'arrière
manie une longue rame fixée sur un bord et nous filons
silencieusement sur l'eau brune, à l'ombre des cocotiers.
A midi, nous déjeunons dans un grand
jardin au bord d'un petit canal couvert de nénuphars
avant de retourner à Saigon et de retrouver l'hôtel
Windsor vers 15 heures. Après avoir posé nos valises,
nous partons seuls à pied vers le quartier chinois. Saigon
est une fournaise, bruyante et encombrée, la ville la
plus densément peuplée du pays.

Rue An Duong Vuong, les marchands de
mobylettes s'alignent les uns à côté des
autres.
D'après l'échelle de notre plan,
le quartier chinois devrait être à 1 km de l'hôtel.
Après une demi-heure de route, nous avons juste parcouru
un tiers du trajet. Nous rebroussons chemin, trop loin, trop
chaud, trop de bruit ! A mon avis, il y a bien 5 km pour se
rendre au quartier chinois, donc 10 aller-retour et le guide
nous attend dans le hall du Windsor à 18h30. Les bus,
on ne sait pas où c'est, les taxis, il ne faut pas prendre
n'importe lesquels à cause des arnaques, et pour se faire
comprendre ici, bonjour !
Mardi 7 décembre
Matinée libre... Nous prenons la navette de l'hôtel
pour nous rendre au centre de Saigon. Nous marchandons une valise
de 1 500 000 dongs que nous obtiendrons pour 1 000 000 dongs,
nous achetons diverses autres bricoles sur le marché
Ben Tanh, traversant de larges carrefours sans feux, zigzaguant
entre les motos. On est sollicité de partout pour monter
sur des motos-taxis, des cyclo-pousses, pour acheter ceci, cela.
On essaie de me vendre trois cartes postales 5 dollars, je les
aurai finalement pour 1/2 dollar, un tee-shirt 1 450 000 dongs
que j'emporte pour 64 000 dongs. On négocie les prix
en écrivant sur la calculette. Nos trois guides nous
ont dit qu'il faut marchander, sinon on brise l'économie.
Nous rentrons à l'hôtel en navette et bouclons
les valises.
Dung vient nous chercher à 13 heures pour aller au restaurant.
Il nous montre quelques mots en vietnamien avec différents
accents qui changent leur sens. Le mot "ma" par exemple,
selon l'accent, aigu, grave, tilde et autres accents inconnus
en français, peut signifier : diable, belle-mère,
de, cheval, pousse de riz...
Nous allons visiter le musée de l'histoire du Vietnam,
sis dans un palais colonial français et où se
trouvent rassemblés de jolis objets anciens, jarres en
terre cuite, dragons, meubles en bois laqué (les Vietnamiens
ont appris la laque, pendant la domination chinoise).
Les bois laqués ont une grande valeur et indique la richesse
de ceux qui en détiennent. Cette valeur augmente avec
le temps et peut décupler en cinquante ans. C'est un
peu le même principe que le bois de Santal, dont on nous
a parlé à Hoi An. De même, pour reconnaître
les riches des pauvres, il faut compter le nombre de jarres
qu'ils possèdent. Un pauvre peut posséder 3 jarres
pour récupérer l'eau de pluie à la saison
sèche, tandis qu'un riche en aura une centaine.
Un superbe tambour du Yin et du Yang trône dans ce musée.
Il est constitué d'une peau de buffle mâle d'un
côté, et d'une peau de femelle de l'autre qui rendent
des sons différents. Le côté mâle
est destiné à annoncer les mauvaises nouvelles
(la mort par exemple), tandis que l'autre côté
annonce les bonnes (mariage, naissance). Ce tambour est encore
en usage dans les coins reculés.
Après le musée, nous entrons dans un atelier de
laque, sur nacre et écailles d'œufs. On peut y admirer
de très beaux produits finis, au terme d'un travail d'artiste.
La laque nécessite 15 à 17 couches de peinture,
entrecoupées de ponçages avec à la fin
un ponçage final à la noix de coco.
Un peu plus tard, nous nous rendons à la pagode de l'empereur
de Jade, qui comme beaucoup d'autres se trouve sous la garde
d'un banian, l'arbre sous lequel médita le Bouddha. A
côté, est creusé le bassin des carpes et
des tortues, qu'achètent les gens pour les libérer
et qui sont stockées là en attendant d'être
rendues à la nature. A l'intérieur, se tiennent
les trois Bouddhas (passé, présent, avenir), le
Bouddha femme, et les génies du mal et du bien (le Yin
et le Yang). Le fond de la pagode est occupé par l'empereur
de Jade, le roi du taoïsme qui gère l'univers, et
ses ministres, statues géantes en papier mâché
laqué.
Dix tableaux en bois sculpté racontent que celui qui
meurt sans atteindre le Nirvâna, devra essayer de l'atteindre
en dix étapes (sorte de purgatoire), par le cycle des
réincarnations.
Le Génie de la fortune, enfin reçoit
de nombreuses visites. A ses pieds, est posée une corbeille
avec des petits papiers. On peut en emporter un, il portera
chance. Les pauvres prennent un billet rouge plié dans
lequel est représenté le symbole chinois du génie
de la fortune, et s'ils deviennent riches, ils reviendront avec
des offrandes.
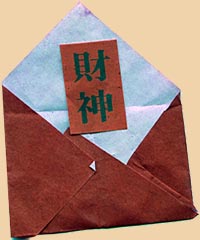
Ce Génie, qui ne respectait pas sa mère,
vit un jour un oisillon apporter des graines à sa mère-oiseau.
Pris de remords, il rentra chez lui et voulut embrasser celle
qui l'avait mis au monde et le nourrissait, mais celle-ci surprise,
recula, tomba et mourut sur le champ. Par la suite, le Génie
devint riche, mais il se rendit compte que la fortune, sans
sa mère, ne lui servait à rien.
Notre dernière visite est pour la poste
coloniale, construite en 1886 et dont l'intérieur a un
air de famille avec celui de la gare d'Orsay à Paris.
Elle fut édifiée par les Français installés
à Saigon de 1858 à 1956. C'est un bâtiment
voûté, absolument superbe, aux cabines téléphoniques
encore dotées de portes en bois, avec sur les murs, des
cartes anciennes de Saigon et de la région et bien sûr,
le sempiternel Hô CHi Minh, tout au fond.
La journée s'avance, avant de gagner l'aéroport,
nous suivons la rue principale (ancienne rue Catina) du quartier
colonial avec ses boutiques et cafés, très prisés
par les Français à l'époque. Nous passons
devant l'opéra, devant les grands hôtels coloniaux,
l'hôtel Caravelle où logeaient journalistes et
correspondants de guerre Américains, le Rex pour les
officiers Américains, le Continental, premier hôtel
français, le Majestic, le plus chic, où séjournaient
les Français au temps des colonies et aussi Catherine
Deneuve quand elle visita le Vietnam, lors du tournage du film
"Indochine". Nous admirons au passage, l'hôtel
de ville de 1900, bâtiment colonial de couleur claire
comme l'opéra et devant lequel trône le pape du
PC, Hô Chi Minh. Le premier arrondissement de Saigon,
le plus beau, en cette période d'avant Noël, ruisselle
de millions de lumières, grands sapins, guirlandes multicolores,
arbres et façades cascadant de fils lumineux.
Au cœur de la ville, demeurent les gens riches, à
la périphérie les classes moyennes, mais il y
a aussi des bidonvilles près du port de Saigon, distant
de la mer de 80 km.
Nous arrivons à l'aéroport, un peu avant 19 heures
et au lieu de décoller à 23h05 comme prévu,
l'avion a 45 mn de retard. Presque cinq heures d'attente, trop
long !
J'ai demandé lors de l'enregistrement des places avec
de l'espace devant et nous sommes, comme à l'aller, au
rang 45, en début de section, avec toute la place qu'on
veut pour les pieds. Miss Martinique est dans le même
vol que nous (en classe affaires).
Mercredi 8 décembre
Arrivée à Roissy à 7 heures locales (13
heures au Vietnam). La voiture est couverte de glace et de givre,
la neige est tombée pendant qu'on se prélassait
au soleil.
Une petite conclusion
sur ce pays que nous venons de quitter :
Un pays chaleureux, meurtri par les guerres innombrables, qui
n'en reste pas moins accueillant et souriant. Pas de mendicité,
de la pauvreté sans doute, comme partout, mais moins
criante que dans certains contrées de l'Asie du sud-est.
Nous n'avons jamais eu l'impression de saleté et de manque
d'hygiène. Quant à la nourriture, ce fut un vrai
régal que tous ces repas asiatiques, explosion de saveurs
et de parfums, subtil mélange d'épices, de douceurs,
d'odeurs... Une nature riche et généreuse, des
merveilles comme la baie d'Halong, des peuples colorés
dans le Haut Tonkin, un fleuve omni-présent leMekong...
Et les fruits... les légumes surprenants... et partout
le riz...
|